Du dimanche 18 février au dimanche 25,
J’ai lu :

Way Inn - Je ne me souviens hélas plus qui, sur Mastodon, m’avait recommandé ce roman qui vient clore (temporairement ?) mon exploration d’hôtels fictionnels. Way Inn commence comme une réflexion sur la banalité des centres d’exposition et des hôtels attenants, ou plutôt leur uniformité totale, venant nourrir mes réflexions autour de L’Hôtel du Lion rouge avec des descriptions me laissant à penser que l’auteur a effectué quelques séjours de recherche… Et puis ça bascule vers une ambiance qu’on pourrait davantage rapprocher de Green Dawn Mall, révélant que certains fils de l’intrigue n’étaient que des trompe-l’œil, dissimulant quelque chose de plus sombre qui ne s’éloigne néanmoins pas du propos initial. Si une telle bascule ne m’a pas gêné, j’ai moins aimé la fin de Way Inn, qui bascule dans quelque chose de trop orienté « action » à mes goûts ; il n’empêche que, pour ses concepts et les images qu’il a allumé dans mon cerveau, c’est un roman qui va m’accompagner un petit temps !
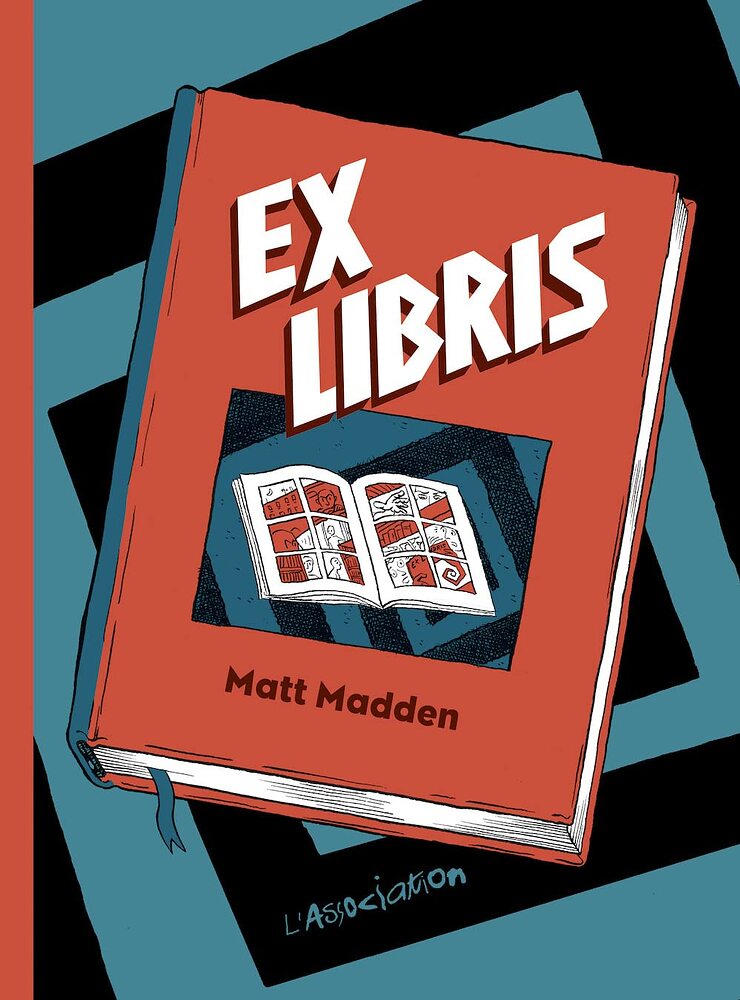
Ex-Libris - Un nouvel opus OuBaPien de Matt Madden, un des hérauts du genre, ça ne pouvait que m’attirer ! Autour du thème on ne peut plus Austerien de la protagoniste enfermée dans une chambre pleine de livres, Madden livre une petite fable qui, sur le plan narratif, n’a pas grand chose d’extraordinaire ; en revanche, sur le plan graphique, c’est fabuleux. On a droit à des extraits de chaque bande dessinée lue par la protagoniste, avec évidemment des styles graphiques différents, pastiches d’à peu près tout ce qui se fait en BD, avec des traits sous lesquels j’ai eu parfois bien du mal à identifier ceux de Madden lui-même. C’est un véritable tour de force, pas le seul en la matière (The Art of Charlie Chan Hock Chye me vient en tête, par exemple) mais maîtrisé de bout en bout et à relire souvent avec le plus grand des plaisirs. Un coup de chapeau, en passant, à la traduction de l’ouvrage en français, qui transpose comme si de rien n’était la plupart des références culturelles !

Marchebranche - Ben dis-donc, apparemment je fais à présent partie de la presse puisqu’on m’envoie des SP pour la compote ! Bon, faut dire que je connais un peu l’éditrice de Dystopia, et Thomas Munier aussi, ça aide… Marchebranche, qui devrait bientôt entrer en phase de précommande, c’est le retour de Thomas à son univers fétiche de Millevaux (non qu’il l’ait réellement quitté…) par une face plus lumineuse qu’Inflorenza, le jeu qui avait révolutionné mon approche du jeu de rôle à l’époque. Ici, on est dans quelque chose de volontairement plus Miyazakesque, avec des histoires de quêtes à gogo, de tarots qui font retrouver la mémoire aux personnages et d’errance à travers des paysages de forêt perpétuelle. Le tout est présenté (aux côtés de superbes illustrations d’Evlyn Moreau) comme une énorme boîte à outils, comme Thomas sait le faire depuis des années maintenant : des règles très simples et très narratives agrémentées de tonnes de conseils et de « tables » aléatoires (davantage des fiches, en réalité) pour construire des campagnes sur mesure. Ça incite franchement à repartir à l’exploration de Millevaux et tout est fait pour qu’on ait immédiatement envie de personnaliser le jeu à sa mesure !

Connexions tome 1 - J’avais patiemment collectionné les 6 volumes de Connexions en version fanzine noir et blanc au fil des festivals d’Angoulême (il y en a maintenant 10) mais je n’avais pas pris le temps de m’avaler le volume en couleur avec corrections et ajouts, c’est désormais chose faite ! Connexions, c’est l’histoire finalement assez banale d’une bande de copaines qui se rencontrent, se quittent, se retrouvent, forment des amitiés et des rancœurs inattendues, le tout raconté comme un bon film français et se laissant lire agréablement. Ce qui élève le volume au-dessus du lot, c’est surtout sa patte graphique, avec ses décors en 3D isomorphique, ses chouettes plans de métro et ses incises narratives en hexagones… Le tout a donc un léger côté OuBaPien, ce qui n’est pas surprenant de la part du co-fondateur des Éditions Polystyrène, un puits d’inspiration formelle pour moi. Bref, j’ai hâte de lire la suite du diptyque !

Paul à la pêche - Moi qui partage avec Paul un désintérêt total pour la pêche, ce tome-ci ne pouvait que me ravir… Comme si le récit de cette excursion au grand air ne suffisait pas (et elle pourrait suffire, tant Rabagliati est fort pour dépeindre le plaisir de se promener en pleine nature), il est bourré de portraits de personnages secondaires, racontés en flashback avec toujours beaucoup de tendresse et d’humanité, transformant n’importe quel personnage en véritable personne. Le dernier tiers de Paul à la pêche m’a particulièrement touché, puisque là encore on parle de parentalité, ou plus exactement de grossesses difficiles, avec, là encore, de la pudeur et de la simplicité. Je comprends à présent ce que disait l’ami Ben en disant que la série des Paul gagnait en qualité et en profondeur au fil des tomes : si les prochains sont encore meilleurs, je vais me régaler !

Rage - Il y a une dizaine d’années, Stephen King n’a pas voulu rééditer Rage, son premier bouquin publié sous pseudonyme, et vu qu’il a inspiré une poignée de fusillades dans des lycées, on le comprend tout à fait… Je ne suis pas assez spécialiste de l’histoire américaine récente pour savoir où en étaient les choses sur ce point dans les années 70, mais il y a en effet quelque chose de glaçant à se glisser dans l’esprit d’un sociopathe pendant 200 pages et à comprendre les raisons qui l’amènent, non pas à faire un massacre dans son lycée, mais à tâcher de s’y faire entendre de ses camarades. Comme d’habitude, King maîtrise son style et ses personnages sur le bout des doigts, et pour une fois c’est agréable d’avoir un rythme qui ne retombe pas et tient dans un format de lecture absorbable en une poignée d’heures. Je n’ai jamais lu The Stand, le prochain sur la liste, mais je sais déjà que ce ne sera pas la même affaire…
Page de pub :

La Trilogie de la vie - Et ça continue, encore et encore… Mais c’est la dernière fois que je t’embête avec mon fou lancement du moment puisqu’il se termine jeudi prochain ! À l’heure où je t’écris, on atteint péniblement les 70%, et il apparaît clairement que la fin est loin d’être garantie. Si j’en crois ma vieille expérience, le boost des dernières 48h devrait nous amener tout juste à notre objectif initial, mais en attendant je ronge mes ongles et épuise à peu près toutes les stratégies marketing que je connais, ce qui implique de bricoler des
GIF, des flyers et des visuels Instagram moches. Un jour, j’aurai assez de budget pour me payer un panneau publicitaire…
J’ai vu :

Bonne conduite - L’affiche de
Bonne conduite dissimule un peu trop bien son mélange des genres : c’est certes, d’un côté, un thriller mâtiné de néons et d’accents à la John Carpenter pour raconter l’histoire d’une monitrice d’auto-école vengeresse, mais d’un autre côté c’est aussi une enquête mélangée à de la comédie un peu absurde, avec à peu près toute l’équipe du Palmashow qui vient faire coucou. Un tel équilibre pourrait être casse-gueule mais fonctionne ici admirablement bien, en privilégiant souvent le plan bien filmé et la punchline bien amenée à des choses plus gratuites. Laure Calamy, comme à son habitude, se donne à fond et est un plaisir à voir à l’écran de bout en bout. Bref, malgré une fin un peu faiblarde,
Bonne conduite mérite de récupérer tous ses points !

Mr. & Mrs. Smith saison 1 - Je ne suis pas plus fan que ça de tout ce qui tourne autour du monde glamour de l’espionnage, mais une série de et avec Donald Glover et Maya Erskine, ça ne pouvait que titiller ma curiosité… Surtout lorsqu’il s’agit d’un remake d’une série oubliée des années 90 avec Scott Bakula et, ah oui, il y a eu un film aussi. On est dans le glamour, donc il ne faut s’attendre à aucun réalisme mais plutôt à des décors somptueux et des épisodes alternant scènes d’action intrépides et passages beaucoup plus lents où le mariage formé par John et Jane Smith est examiné par toutes ses coutures, de la rencontre à la rupture, chaque mission servant peu ou prou à faire un parallèle avec la situation du couple. C’est de la série de divertissement qui se laisse regarder très agréablement grâce aux prises de vue d'Hiro Murai, bref, quelque chose d’idéal pour les vacances !
J’ai joué à :
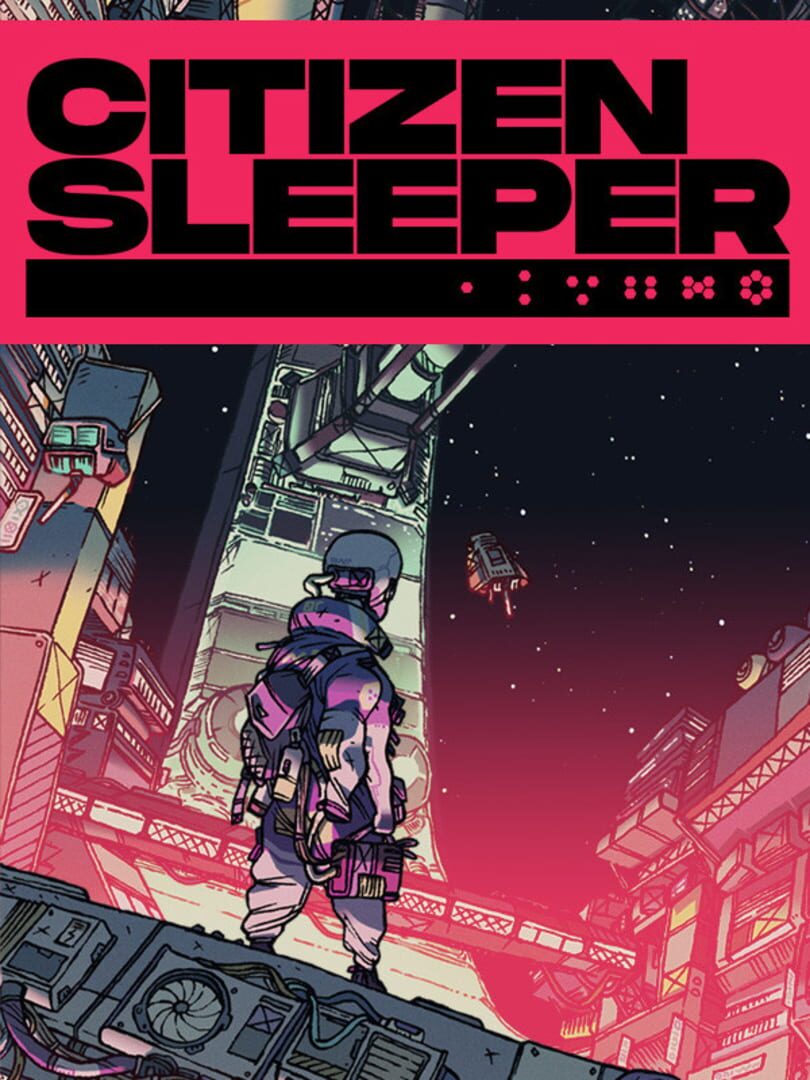
Citizen Sleeper - Avec le lobbying intense que Melville me fait depuis quelques mois (c’est intolérable, ça consiste à me dire une fois par mois « tu devrais jouer à ce jeu »), je me devais de tester
Citizen Sleeper… Je ne suis pas particulièrement fana des jeux narratifs, trouvant mon lot de longs textes intéressants à lire ailleurs, et initialement c’est surtout l’aspect gestion du jeu qui m’a attiré : comment faire pour remplir plus de tâches par jour qu’on a d’énergie pour, comment se débrouiller pour survivre dans une station spatiale en déliquescence où, concrètement, tout le monde se fiche de vous… sauf quelques bonnes âmes auxquelles on s’accroche, même si elles-mêmes vous aident parfois pour de mauvaises raisons. Et puis on fait son trou, on donne des coups de main ici et là, et cette station spatiale commence à ressembler à un foyer. Alors, quand vient le moment de choisir si on doit la quitter ou y rester, le choix est plus difficile qu’il n’y paraît… Et voilà, je me suis fait avoir par l’aspect narratif de
Citizen Sleeper et me suis pris d’intérêt pour ses personnages complexes, développés, touchants, à commencer par le protagoniste. Au final et sans surprise, Melville avait raison…
J’ai écouté :

Buck 65, Dirtbike 1-4 - Comment aborder cette somme absurde que sont les 4 albums formant le projet
Dirtbike ? Ça commence fin 2008 : entre deux albums officiels, Richard Terfry, qui est décidément en forme à l’époque, décide de sortir trois albums en trois mois. Je ne vais pas y aller par quatre chemins : c’est probablement ce que Buck 65 a fait de mieux entre 2000 et 2020, trois heures de hip-hop expérimental qui part dans tous les sens, résolument lo-fi, une sorte de centre névralgique qui agglomérerait toutes les facettes de la musique de Buck. Sur
Dirtbike 1, on trouve ainsi aussi bien une
bombe de piste de danse qu’une
reprise à l’ancienne,
un titre méta ou
une douce chanson d’amour, avec une
reprise de
vidéo YouTube et 30 secondes de
“I Like To Move It” pour faire bonne mesure (et je te parle même pas du
featuring de doseone qui fait le pont entre les deux versions de
North American Adonis…). C’est un bazar total dont les rebonds sont impossibles à prévoir et à mes yeux le meilleur des 4 albums, peut-être parce que le premier.
Dirtbike 2 prend
par moments des
accents folk, mais va également chercher vers
la douceur dont on reparlera un peu quand il s’agira de
20 Old Years). Mais ce sont loin d’être les versants de l’album, qui, s’il manque un peu de moments mémorables, contient tout de même une reprise improbable d’Al Tuck, un
tube d’Halloween, du hip-hop dada de haute tenue et même une petite reprise de “Style #386” (mais il te faudra bien écouter pour tout cela car ce 2e volet manque d’extraits disponibles).
Dirtbike 3, lui, a des sonorités plus pop-rock, avec des titres comme
“Roadkill” sur lesquels Buck s’efface totalement (pour un résultat très moyen, et ce ne sera hélas pas la dernière fois…), “Queen of the Shitbags” ou
“Why So Sad” (qui ressort le banjo, il n’est jamais loin je te dis !), et avec des interludes où les percussions tapent fort comme il se doit, mais n’oublie pas le rap pour autant, avec
un excellent featuring avec Sage Francis, des bizarreries comme seul lui sait le faire (“Microwave Popcorn”, “No Way Out” ou un titre sur le vagin parce que pourquoi pas), des
choses plus sombres (mais toujours avec banjo) et un dernier morceau achevant de mettre le projet sur orbite ; c’est aussi et une fois de plus l’occasion de créer ]un petit récit](https://youtu.be/svj8QE4qB40?feature=shared&t=464) en quelques minutes, de faire un peu de hip-punk avec “Curious”, un peu de hip-folk avec
“Whoa Back Buck”, un peu de hip-emo avec “Nothing Rhymes With Woman”… Bref, à nouveau un grand mélange qui verse parfois dans le n’importe quoi mais est tellement unique en son genre que je ne me lasse jamais de l’écouter. Et tout ceci était déjà pas mal, peut-être même trop, sincèrement, mais Terfry ne s’arrêta pas là et sortit, l’air de rien, un
Dirtbike 4 en 2015, juste avant son long congé. Ce 4e opus de la trilogie, pour ainsi dire, est encore plus lo-fi que les précédents, avec des morceaux n’excédant que rarement les 2 minutes et touchant à des sujets aussi divers que savoir qui a pété (oui, bon, il fallait être là quand
la première partie était sortie), des histoires de
creusage de tunnel et de taïga Sibérienne, une attaque contre The Police, un hommage à
Kevin (le chat de Terfry), une reprise des plus étranges de “Imagine” de John Lennon, et presque comme attendu, une complainte sur son ex. Bref, c’était encore une fois n’importe quoi, un grand foutoir punk, l’assurance que Terfry en avait encore sous la semelle et qu’il ne s’était pas perdu dans un bouillon de pop commerciale… Mais une fois encore, je vais trop vite : tellement d’ailleurs que nous sommes déjà en 2008 et que j’ai oublié de te parler de Dirk Thornton, un avatar créé l’année précédente ! Je me rattrape la semaine prochaine.
L’arrière-queer de Milouch :

Heavystériques - J'ai eu une grosse période où j'écoutais beaucoup de métal. Même si ça m’est un peu passé, ça reste des musiques que j'aime bien et je suis un peu les actualités de la scène de très loin. Il y a quelques semaines, j'ai eue la chance de tomber sur l'incroyable
HEAVYSTÉRIQUE (et son fantastique slogan : « Le podcast des hystériques d'une scène gangrenée par les mascus »). C'est un podcast qui parle des expériences de meufs et de personnes en minorités de genre dans le milieu des musiques métal. Les épisodes racontent à chaque fois des histoires personnelles de musicienne, barmaid, illustratrice, programmatrice... Ces histoires sont individuelles mais elles mettent très bien en avant les gros problèmes de patriarcat et de sexisme présents dans le métal (et dans l'ensemble de la société d'ailleurs). Loin de se cacher derrière son petit doigt, le podcast prend à bras le corps ces questions et n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat (et elles ont bien raison). Chaque épisode se conclut par les recommandations de groupes qui ne sont pas uniquement composé de mec cis het blanc... Et j'ai pu ainsi faire la découverte de l'incroyable
windhand, un groupe de black métal si gras qu'il vous donnera la sensation de devenir un tractopelle pendant quelques minutes. Mais il nous faudra peut être au moins ça.
Et toi :

Cédric :
Gueules noires est un film fantastique français qui raconte comment un jeune marocain (incarné par Amir El Kacem) quitte son pays en 1956 pour aller travailler dans les mines du nord de la France. Il y intègre une équipe de mineurs plutôt rude dirigée par Roland (Samuel Le Bihan). Le directeur de la mine (joué par Philippe Torreton) leur impose toutefois une mission : accompagner le mystérieux Professeur Berthier (Jean-Hugues Anglade) qui souhaite descendre tout au fond de la mine pour faire des prélèvements. Évidemment, tout va partir en sucette. La première partie du film est de très bonne facture : la reconstitution de l'ambiance crade des mines est très bien rendue : on y croit, à ces vies de misère. La saleté dégouline, les mineurs sont bruts de décoffrage, les scènes de sous-sol sont oppressantes... Tout fonctionne à merveille. Et puis, sans grande surprise, les personnages réveillent une créature et à partir de là, ça se gâte pour eux mais aussi pour le spectateur car le réalisateur (qui a été assistant-réalisateur pour Tarantino et Guy Ritchie) fait un choix pas très payant : celui de rapidement montrer le monstre au lieu de le suggérer. Et il faut l'admettre, le costume de la créature n'est pas très réussi, quand il est filmé en gros plan. Si bien qu'on passe d'une ambiance poisseuse à un truc un peu grand-guignol qui désamorce toute l'horreur cosmique qui était supposée nous étreindre. Car oui, c'est éminemment lovecraftien, le scénariste ne s'en cache pas puisqu'il cite littéralement le Maître de Providence dans un dialogue du film. Et comme le monstre est un peu grotesque, notre esprit n'est plus complètement embarqué dans l'histoire, si bien qu'on remarque les incohérences qui s'amoncèlent. Par exemple, comment les gens qui se sont battus la première fois contre la bête avec leurs épées et leurs boucliers ont fait pour atteindre des profondeurs pareilles en leur temps ? C'est franchement dommage, les personnages étaient intéressants, l'atmosphère était inspirante, ça promettait un film haletant, mais ce scrogneugneuh de monstre est venu tout gâcher.
Et toi, qu’as-tu compoté cette semaine ?
Des bises
et peut-être à dimanche prochain !

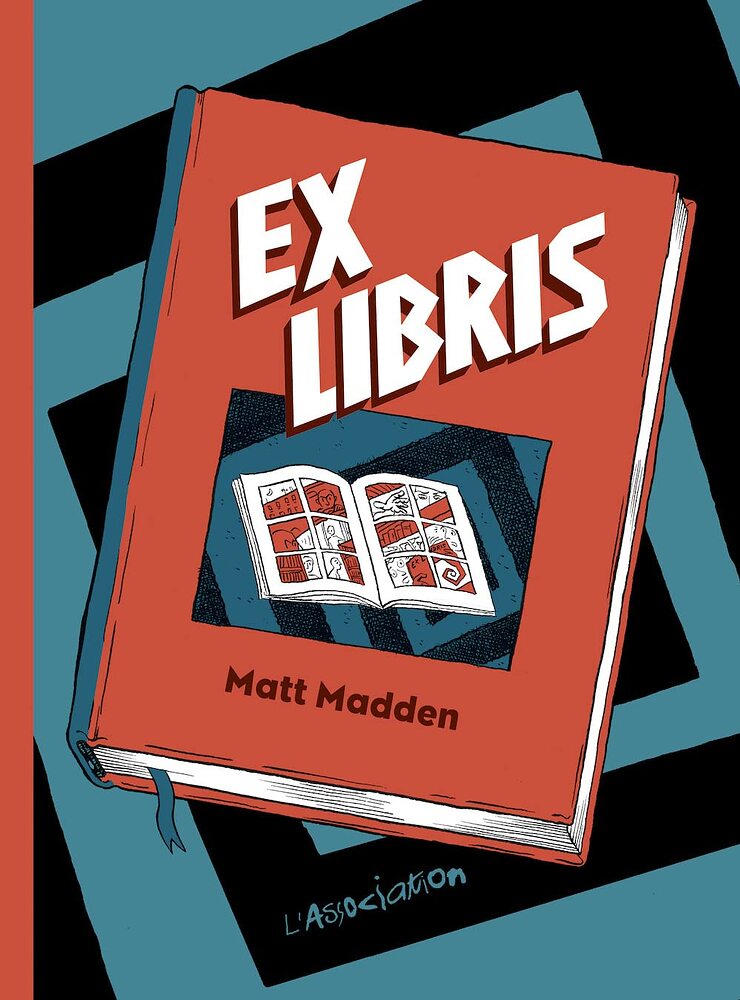







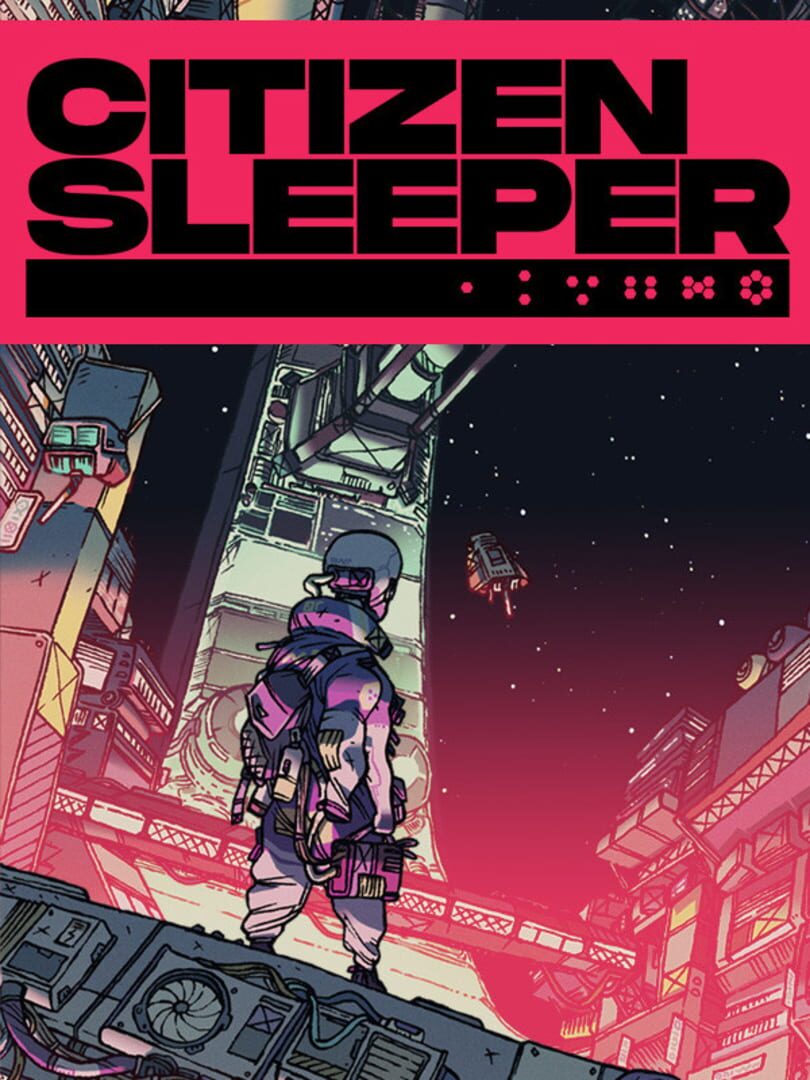



Ajouter un commentaire: